
HARKIS : Formes et limites de l’emploi des harkis dans les opérations
Les armées françaises ont une longue tradition d’emploi de troupes « indigènes ». Leur rôle est régulièrement évoqué lorsque l’on parle des deux guerres mondiales en particulier, ainsi que lorsque l’on traite des opérations de conquête et de pacification de la période coloniale. De même, la présence de contingents d’Afrique noire et d’Afrique du Nord en Indochine jusqu’en 1954 est bien connue et ne suscite pas de polémiques majeures. Qu’il s’agisse de troupes régulières ou supplétives, ces formations sont reconnues, étudiées, et sont très rarement remises en question.
Il en va bien sûr différemment pour la guerre d’Algérie, dont on sait bien qu’elle reste un thème sensible, sujet à de nombreuses polémiques. Pour commencer, cela a déjà été dit mais il est à mon sens important d’insister sur ce point, je veux remercier la fondation d’avoir organisé deux journées de colloque sur cet aspect douloureux d’un conflit dont les cicatrices peinent à se refermer, un thème sur lequel circulent beaucoup d’idées reçues, d’affirmations péremptoires trop rapides, un thème sur lequel les historiens ont encore, à froid, de très nombreuses pistes à creuser.
De quoi me suis-je servi pour préparer cette intervention ? D’archives, bien sûr, mais aussi de témoignages, que j’utilise toujours avec d’autant plus de soins et de précautions que le sujet reste polémique et qu’il est indispensable de « baliser » à chaque pas la réflexion. Par ailleurs, plus un conflit dure longtemps, plus son étendue géographique est vaste, plus il engerbe des effectifs importants, et plus vous disposerez d’un véritable caléidoscope de témoignages. Il n’y a pas une vérité générale qui s’impose partout et toujours, mais des situations évolutives, complexes et plurielles, en fonction des individus, du temps et des lieux. Pour éviter les redondances avec ce que vient de dire le général Faivre, j’ai décalé mon point de vue et je vais essayer d’aborder cette question de l’emploi des Harkis du point de vue du commandement français : quelles missions leur donne-t-on ? Quelles limites y met-on ? Comment les situations évoluent-elles ?
Pourquoi ce choix : parce qu’une guerre est toujours conduite, au sens propre. Il n’y a pas (ou extrêmement rarement) de génération spontanée sur le terrain d’unités particulières décidant de mener leur propre guerre. L’organisation militaire fortement hiérarchisée développe son action dans un cadre réglementaire, normé, avec (normalement) un objectif politique défini par la puissance publique, un état-major central qui décide des directives générales en cohérence avec les choix gouvernementaux, des états-majors subordonnés et des unités qui mettent en œuvre sur le terrain les ordres reçus. Les recrutements de tel ou tel type de combattants, leur formation, leur équipement et leur emploi relèvent de décisions prises au niveau supérieur et l’engagement de l’unité X, Y ou Z a été prévu dans le cadre d’une certaine conception de la guerre et de sa conduite. En un mot, lorsqu’un type d’unité connait un fort développement, il n’y a pas de « génération spontanée » et ces formations, même supplétives, s’inscrivent dans un processus d’ensemble.
Je vous propose donc d’évaluer comment et dans quels buts ces détachements, par ailleurs extrêmement divers quant à leurs statuts, à leur emploi, à leurs missions, ont été engagés, et d’en tirer quelques conclusions et enseignements.
Globalement, l’emploi des unités harkis suit l’évolution générale de la conduite de la guerre d’Algérie. On distingue généralement trois périodes : une première phase d’incompréhension par les autorités politiques et militaires des « événements » qui se déroulent sur le sol algérien, une deuxième phase marquée par des tentatives d’adaptation peu convaincantes, et une troisième enfin de succès effectifs remportés sur le terrain, au point que l’ALN ne compte plus à la fin de la guerre que quelques petits groupes mal équipés pour l’essentiel incapables de lancer des opérations d’envergure. Parallèlement, se pose la question de l’emploi de ces troupes levées sur le territoire dans le cadre générale d’une stratégie contre-insurrectionnelle, de plus en plus fréquemment comprise au fur et à mesure que le conflit dure comme une « guerre révolutionnaire » par une partie significative de l’encadrement français, tandis qu’à Paris les états-majors centraux ont aussi des préoccupations de guerre conventionnelle sur le théâtre européen.
Quels sont les effectifs déployés sur le terrain ? Dans un premier temps, seuls sont concernés les trois petits corps d’armée stationnés sur le territoire algérien, dont le volume ne va pas cesser de croître au fil du temps : 50 à 55.000 hommes au début de ce que l’on appelait les « événements », de l’ordre de 80.000 hommes cinq mois plus tard, 120.000 moins d’un an après le début de l’insurrection. Dès le printemps 1955 les premières mesures de rappel partiel du contingent sont décidées, donnant le signal d’un mouvement qui va s’accélérer et s’élargir pendant de longs mois. In abstracto, ces volumes peuvent paraître importants. En chiffres bruts, et en considération de ce que représente alors l’armée française de métropole, ils le sont. Mais il ne faut pas se cacher le fait qu’à l’échelle du territoire à couvrir ils resteront toujours trop faibles par rapport aux besoins. Rappelons-nous l’enseignement tirés par les Britanniques de leur engagement en Malaisie : pour venir à bout d’un rebelle, il faut vingt soldats loyalistes. Pour tenir et pacifier dans son ensemble un territoire et espérer réduire la rébellion qui y prospère, il faut donc un rapport de 20 contre 1. On voit bien qu’à aucun moment, si ce n’est dans certain secteurs tout-à-fait à la fin du conflit, ce ratio n’a été atteint en Algérie. A ce constat, s’ajoute un certain nombre de difficultés chroniques, et en particulier le manque d’encadrement. Or, de même qu’une unité ne mène pas sa propre guerre, aucune troupe ne combat sans chefs. A partir de l’été 1955, avec la montée en puissance du nombre des rappelés, toutes les unités sont frappées par un déficit marqué en encadrement officier et sous-officier d’expérience. Ajoutant aux difficultés, le matériel est souvent inadapté, et il suffit pour s’en convaincre de lire ce qu’écrit à l’époque la direction de la cavalerie. La rusticité, indispensable, ne permet pas seule de pallier toutes les carences et dans toutes les armes les « bricolages » locaux sont nombreux pour adapter les dotations aux besoins. Enfin, se pose le problème de la rotation rapide des unités, qui désorganise l’action sur le terrain et souvent interdit de mener dans la durée des actions de fond.
Dans un premier temps, la réponse française à l’insurrection va être celle somme toute classique d’un Etat européen confronté à une révolte traditionnelle outre-mer, presque un « soulèvement tribal » comme au XIXe siècle, avec une priorité accordée aux mesure de répression policière et au maintien de la sécurité publique. Rapidement, l’engagement d’unités dans des opérations au sens strictement militaire du terme est perçu comme une nécessité. Si, ponctuellement, le calme peut être ramené autour d’une commune, les forces déployées dans ce secteur ne restent pas assez longtemps présentes sur le terrain pour tirer les fruits dans la durée de la tranquillité rétablie. Dès le premier résultat (apparent) obtenu, les compagnies quittent la zone concernée, … et la rébellion se réinstalle derrière elles. Une région soi-disant pacifiée retombe à quelques semaines sous l’influence des insurgés. Ce constat justifie le rappel des conscrits (il faut pouvoir disposer d’effectifs importants implantés sur l’ensemble du territoire) et le recrutement de la population locale, pour qu’elle participe à sa propre défense.
Progressivement, l’augmentation du nombre de Harkis et de supplétifs correspond ainsi à un effort pour, d’abord, assurer l’ordre public et une certaine sécurité générale. C’est tout la politique de quadrillage et de contrôle du territoire qui est ici illustrée. Par contre, dans une première phase, ils ne sont pratiquement pas utilisés dans la recherche du renseignement ou dans des actions offensives sur la base de renseignements, politique qui ne se développe que dans la dernière phase de la guerre, essentiellement à partir de 1959.
En 1954-1956, les unités supplétives sont donc presque essentiellement consacrées à des missions de défense statique, au premier chef pour leurs propres villages. Très peu d’infiltrations, pratiquement aucune opération d’intoxication de l’adversaire, maigre contribution à la recherche du renseignement, et un emploi offensif qui reste marginal constituent les principales caractéristiques de cette période.
De même, on observe chez les cadres français une vive réticence à structurer et à utiliser des groupes de ralliés qui pourraient porter le désordre chez l’adversaire en utilisant ses armes et méthodes. Ce mode d’action ne sera que tardivement expérimenté et n’atteindra jamais l’ampleur de ce que les Britanniques systématisent à la même époque au Kenya. Dans une armée fortement imprégnée de principes traditionnels et dont le haut commandement manque d’audace, les uns et les autres se demandent jusqu’où est-il possible de leur faire confiance ? Puisqu’ils ont une première fois trahi la rébellion pour les Français, ne risquent-ils de changer de camp une nouvelle fois, après avoir été armés et instruits, pour retrouver leurs camarades ?
Il faut aussi mentionner durant cette période l’expérience conduite par le général Parlange, commandant politico-militaire -ou politique et militaire- dans les Aurès à partir d’avril 1955, mise en œuvre sur la base de sous-officiers des Affaires indigènes et d’officiers des Affaires sahariennes. Pour que ce type d’action soit efficace, pour obtenir des résultats appréciables dans la durée, il est clair qu’il est indispensable de disposer de cadres formés, dotés d’une expérience significative, qui connaissent culturellement les populations, qui aient vécu avec elles, travaillé longtemps dans la région et si possible parlent la langue vernaculaire. Ici, les jeunes officiers métropolitains rapidement affectés dans des villages isolés ne peuvent, dans l’immense majorité des cas, n’être d’aucune utilité, quelle que soit leur bonne volonté.
Nous sommes donc dans la période durant laquelle prime la logique de défense de proximité, aux abords immédiats d’une communauté. L’expérience est ultérieurement étendue en Kabylie, puis se poursuit avec la création d’un groupe mobile, toujours encadré par des officiers français. On constate d’ailleurs que pour honorer les effectifs nécessaires, le dernier arrivé est parfois (souvent ?) affecté sur un tel poste… En dépit de la qualité individuelle des intéressés et (parfois ?) de leur investissement personnel, cette absence de formation adaptée et ce déficit d’expérience dans un domaine aussi particulier, a pu conduire à de cruels déboires.
Une seconde phase s’ouvre avec les années 1956-1958 et la densification du maillage statique du territoire, à deux niveaux, militaire et administratif, et en recherchant progressivement une juxtaposition entre les circonscriptions territoriales militaires et les limites administratives : c’est la grande époque des unités en secteur et sous-secteur, parallèlement le développement d’une structure spécialisée de recherche du renseignement avec la mise en place d’un réseau complet d’officiers de renseignement. A nouveau, cette initiative louable ne peut coller au terrain et produire tous ses effets que si les cadres hexagonaux ont été en amont longuement formés aux populations et à leurs territoires. Se pose, encore, la question de la confiance, ou non, accordée aux supplétifs et ralliés. Après tout, ce sont eux qui vivent dans la région, qui la connaissent dans ses moindres recoins et c’est à leur bénéfice que des unités extérieures sont engagées… En fonction des moyens disponibles et de la compréhension de la situation locale par le commandement de contact, les résultats sont très variables d’une région à l’autre. Ce maillage, avec le développement des SAS, est la dernière manifestation d’une longue tradition de l’armée française, ultime avatar des bureaux arabes et des bureaux des affaires indigènes du siècle précédent. Mais devant l’ampleur prise par le phénomène, les moyens deviennent nettement insuffisants.
Parallèlement, se développe une politique d’association croissante des notables locaux à la gestion et à l’administration des villages, de recensement de la population, de mesures supposées faciliter la circulation économique, etc., dans le but de donner un sentiment général de sécurité et de proximité.
Cette politique porte ses fruits dans différents secteurs, mais il s’agit toujours d’une conception purement défensive de la lutte contre la rébellion. Chacun défend son propre village, l’endroit où il vit, où il travaille et où est installée sa famille. Mais, au cours de l’année 1956, on constate également un certain nombre d’échecs avérés, dont l’analyse va entraîner des réorganisations et de nouvelles mesures de mise en œuvre.
Emergent alors toutes les notions qui tournent autour de ce que l’on appellera la « guerre psychologique ». Il s’agit d’un domaine particulièrement sensible parce qu’il touche à la fois au quotidien et aux convictions des populations locales, et qui peut s’avérer extrêmement contre-productif s’il est « improvisé ». Le commandement français, durant cette période, hésite toujours sur la conduite à tenir à l’égard des Harkis : le recrutement de cadres locaux est favorisé, mais pour des responsabilités subalternes. Jusqu’où faut-il aller ? Jusqu’à quel niveau et avec quel degré de confiance ? Sans qu’il s’agisse d’une vérité générale et absolue, on constate souvent que les officiers de contact s’efforcent souvent d’investir sur les populations locales et se déclarent plutôt favorables à un élargissement et à un approfondissement de ces mesures, tandis que plus on remonte dans l’organigramme, plus on s’éloigne du terrain, et plus les doutes deviennent prégnants, plus les interrogations sont régulières, plus les hésitations sont fortes. A nouveau, se pose toutes les questions liées à l’armement, à l’encadrement, à l’autonomie qu’il est souhaitable de laisser à ces unités de Harkis ou de ralliés.
Puisque toute guerre est conduite à l’échelon politico-militaire et à l’échelle d’un théâtre d’opérations, cette problématique est intégrée, par le commandement militaire, au débat quasi-quotidien, aux choix parfois cruels, entre la priorité qu’il est nécessaire de consacrer à la mobilité et à l’offensive, et l’effort indispensable qui doit être consenti au bénéfice de la défense statique, locale. Face aux déficits en personnel, c’est un arbitrage permanent en fonction des directives des autorités nationales, de l’évolution de la situation tactique, des ressources disponibles. Et, dans la réalité quotidiennement vécue, il n’y a pas de réponse-type, idéale ; il s’agit toujours de faire en choix en responsabilité entre deux « moins mauvaises » solutions. Dans ce cadre, la contribution des populations locales et des troupes supplétives est à la fois plus immédiatement utile, moins coûteuse et moins potentiellement risquée avec une contribution au maillage territorial statique que dans la composante mobile et offensive. On peut, bien sûr, citer quelques commandos prestigieux, quelques unités célèbres. Mais les mêmes noms sont toujours cités et, numériquement, en pourcentage du total des troupes déployées, elles ne représentent qu’un effectif presque marginal. Ces troupes auxiliaires, d’ailleurs, ne figurent toujours pas, en tant que telles, à l’organigramme de la réserve générale.
En fait, un tournant s’opère en 1959 lorsqu’elles commencent à être engagées un peu plus systématiquement dans des opérations offensives. Le plus importants résultats obtenus par les formations « indigènes » le sont entre 1959 et 1961, avec cet avantage aux yeux du commandement de libérer des troupes métropolitaines pour d’autres missions ou pour les engager ailleurs. On perçoit bien ici les choix cornéliens auxquels est confronté le commandement, dans la planification de chaque opération, presque au jour le jour en fonction des secteurs, pour envisager la contribution de tel type d’unités, dans telle ou telle proportion et jusqu’à tel ou tel niveau.
Les commandos de chasse et les groupements parachutistes sont désormais régulièrement guidés par des éclaireurs harkis, appréciés. C’est donc surtout à partir de 1960, avec la possibilité pour les Harkis d’être directement intégrés dans l’armée régulière, que se concrétise ce qui, quelques années plus tard, formera le socle de la mémoire combattante des harkis et de leurs chefs métropolitains, ce partage des souffrances et des succès dans l’action qui scellera dans des expériences communes une fidélité particulière. A la même époque, l’équipement de ces unités s’améliore et se modernise. Durant toutes les premières années de la guerre d’Algérie, les contingents levés localement ont été équipés d’un armement individuel inférieur en qualité et en quantité à celui des troupes régulières, mais aussi insuffisant par rapport à ce qui aurait été nécessaire. Dans le même temps, un ultime pas est franchi avec l’utilisation offensive d’agents ralliés, retournés, infiltrés, en particulier lors des opérations Emeraude et Rubis. Enfin, dernière étape, se pose la question de faire assurer la gestion de la sécurité des zones pacifiées par les seuls groupes harkis. Il ne s’agit pas encore d’enlever toutes les troupes métropolitaines dans un certain nombre de secteurs, mais le sujet, à terme, pourrait devenir d’actualité. Quant à faire assurer le commandement de ces zones par une élite locale sortie du rang, c’est encore plus délicat et personne ne s’y hasarde. Finalement, le processus, engagé trop tardivement par prudence initiale excessive, restera non abouti.
Pour conclure, on distingue donc bien au cours de cette guerre d’Algérie trois périodes distinctes dans l’utilisation des Harkis qui correspondent bien aux trois grandes phases d’évolution du conflit lui-même. Très lourdes dans un premier temps, réticences et réserves semblent diminuer avec le temps, au moins dans le discours officiel et institutionnel. Deux raisons objectives peuvent expliquer ce changement. D’une part, la montée en puissance des unités de Harkis permet de bénéficier de nouvelles ressources alors que le manque d’hommes est récurrent. Il s’agit souvent davantage, lors de la décision de créer ces formations, de répondre à un besoin plutôt que de témoigner d’une confiance partagée. D’autre part, pendant toute cette période, l’armée française est partagée, tiraillée entre deux, voire trois, priorités divergentes. Pour schématiser, le ministère de la Défense nationale et les états-majors centraux travaillent sur la problématique de la défense européenne, et son coût. On trouve alors en Algérie une armée nombreuse mais plutôt rustique, et en métropole une armée en sous-effectif qui attend sa modernisation. Sur cette problématique, vient se greffer à la fin des années 1950 la question de l’arme atomique dont la France va se doter et dont il faut préparer l’arrivée (unités, vecteurs, etc.). L’armée doit donc gérer pour l’ensemble de ce qui constitue alors la France trois priorités différentes (guerre d’Algérie, modernisation sur le théâtre européen, arme atomique), dans un contexte de très fortes contraintes financières et matérielles dans tous les domaines. Pendant plusieurs années, tout en gérant les déficits, on tente de tout faire avec des moyens insuffisants. Puis un jour vient l’heure des choix. Le recrutement d’un nombre croissant de Harkis et leur engagement de plus en plus marqué dans les opérations offensives a pu, à haut niveau, apparaître comme une opportunité pour trouver une hypothétique quadrature du cercle, mais lorsque l’autorité politique exprimera fermement ses décisions le choix sera fait sans grande hésitation d’une armée moderne orientée vers le théâtre est-européen.
Ne nous trompons pas de niveau d’analyse. La perception, la compréhension, les attachements liés à la guerre d’Algérie étaient, par nature, profondément différents entre les unités déployées outre-Méditerranée et les centres de décision métropolitains. Sans doute faut-il chercher dans les conditions d’abandon de l’essentiel des unités, en 1962, et dans le sort qui fut alors celui de nombreux Harkis, la cause principale du brouillard parfois teinté de romantisme qui entoure encore le sujet. Puisse ce colloque favoriser de nouvelles recherches, dans l’esprit de la fondation, dans le respect de la mémoire de tous et de la mémoire de tout.
LCL Rémy PORTE, membre du Conseil scientifique de la FM-GACMT
FM-GACMT 2013
Texte de l'intervention faite au Colloque : Les Harkis, des mémoires à l'histoire, organisé par la FMGACMT les 29 et 30 septembre 2013.
Vous aimerez aussi
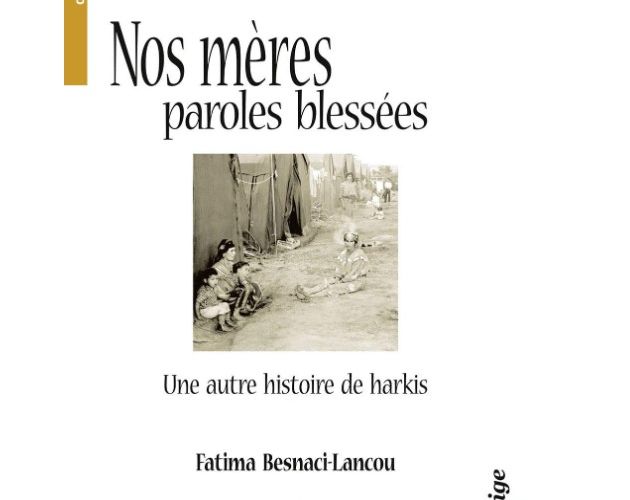
Nos mères, paroles blessées. Une autre histoire des harkis

Du 11 au 13 avril Festival du livre de Paris 2025 : le Maroc mis à l'honneur

Exposition : Images d'Algérie de Pierre Bourdieu (photos en ligne)

EXPOSITION : Méditerranées : Inventions et représentation

NOS POSITIONS : Boualem Sansal

Cérémonie de recueillement, le 26 mars 2025 : 63e anniversaire de la fusillade rue d'Isly à Alger
Restez informés !
Recevez nos dernières nouvelles directement dans votre boîte mail.
Restons connectés !

Ce site a été réalisé avec le soutien du Ministère des Armées
